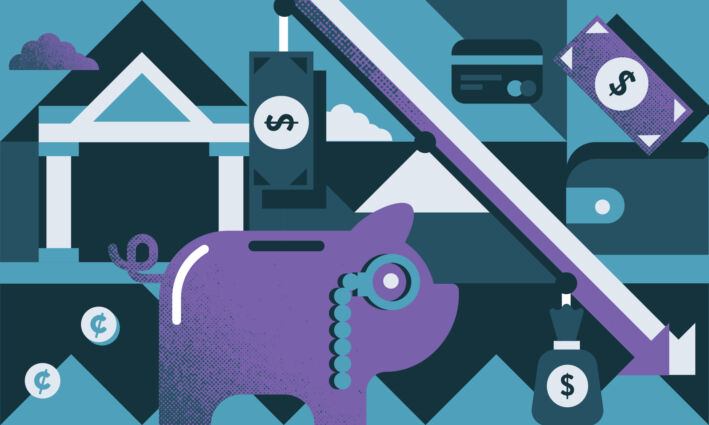Malgré des mois d’objections et de propositions fondées venues de toutes parts, le gouvernement sera resté inflexible dans sa détermination d’introduire de nouvelles obligations et sanctions à l’aide sociale. L’adoption du projet de loi 70 est chose faite et le programme Objectif emploi deviendra la porte d’entrée pour les premiers demandeurs d’aide sociale. Il faut maintenant craindre les modifications réglementaires qui viendront les contraindre au plan d’intervention vers l’emploi qu’on leur imposera.
De quelle ampleur seront les sanctions sur le revenu assuré aux prestataires ? Un regard dans le rétroviseur est impératif pour prendre la mesure de la pente descendante sur laquelle celles-ci risquent de s’ajouter. Si l’intention reste de les appliquer non seulement sur les suppléments accordés, mais aussi sur la prestation de base, elles viendront grever un barème déjà hypothéqué au cours des ans par de multiples pénalités.
Selon la feuille de calcul de l’inflation de la Banque du Canada, la prestation de base mensuelle accordée à une personne seule en 1970 vaudrait aujourd’hui 1 048 $, soit 12 576 $ sur un an. Une prestation de ce niveau en 2016 assurerait un revenu disponible de 13 885 $ si l’on tient compte des crédits pour la solidarité et pour la TPS. La prestation de base actuelle pour les personnes jugées sans contraintes à l’emploi est plutôt de 623 $, soit 7 476 $ sur un an, pour un revenu disponible de 8 712 $ avec les mêmes crédits.
Appliqué aujourd’hui, le critère de 1970 assurerait un revenu disponible équivalant à 73 % du seuil de la mesure du panier de consommation (MPC) pour une personne seule à Montréal. Le critère actuel n’en assure plus que 46 %.
L’histoire de cette dépréciation en montre les points d’inflexion. La valeur de la prestation de base a diminué en 1974 au moment d’une harmonisation avec le salaire minimum. Elle a été réduite au tournant des années 1990 pour amortir le coût de l’abandon d’une prestation beaucoup moindre imposée aux moins de 30 ans. La chute la plus drastique est survenue en 1995 quand on a éliminé le barème accordé aux prestataires en attente de mesures d’emploi auquel elle correspondait. Ces prestataires ont été reclassés d’un seul coup au barème qui pénalisait les refus de participation, une coupe radicale qui équivaudrait aujourd’hui à voir passer sa prestation de 805 $ à 700 $. Ajoutons plusieurs années sans indexation ou de demi-indexation depuis 1996, toujours pour inciter à l’emploi, et nous arrivons au barème actuel de 623 $.
On le voit : il n’y a pas de limites quand le critère de l’incitation à l’emploi remplace le droit à une aide financière « sur la base du déficit qui existe entre les besoins d’une famille ou d’une personne seule et les revenus dont elle dispose » énoncé en 1969 dans la première loi sur l’aide sociale. Pire, on en perd la mémoire à mesure que la valeur de la prestation baisse. Et on recommence.
Une personne sur dix au Québec, dont l’ensemble des personnes à l’aide sociale, est privée du revenu nécessaire pour couvrir ses besoins de base selon la MPC. Ce déficit de couverture se chiffrait à 3,6 G$ en 2011. Il aurait pu être résolu simplement en faisant primer l’amélioration du niveau de vie des plus pauvres sur celui des plus riches entre 2002 et 2011. On a fait le contraire.
Assurer la couverture des besoins de base est un passage obligé pour « tendre vers un Québec sans pauvreté » comme y engage la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Ce pas est possible, à condition que la volonté politique soit présente, qu’on s’intéresse à la distribution des revenus sur l’ensemble de la population et qu’on arrête de poursuivre les plus pauvres au dollar près. Cela commence par cesser de « dégarantir » la prestation d’aide sociale de base.
Ce billet a été rédigé par Vivian Labrie, chercheure à l'IRIS, un think-tank progressiste basé à Montréal.